En 1998, je suis en deuxième année de thèse et je participe aux travaux du laboratoire MEGADIPE de l’Université de Lille 3 et Lille 1. La publication d’un ouvrage collectif va me permettre d’effectuer un retour réflexif sur mon parcours de vie, personnelle et professionnelle.
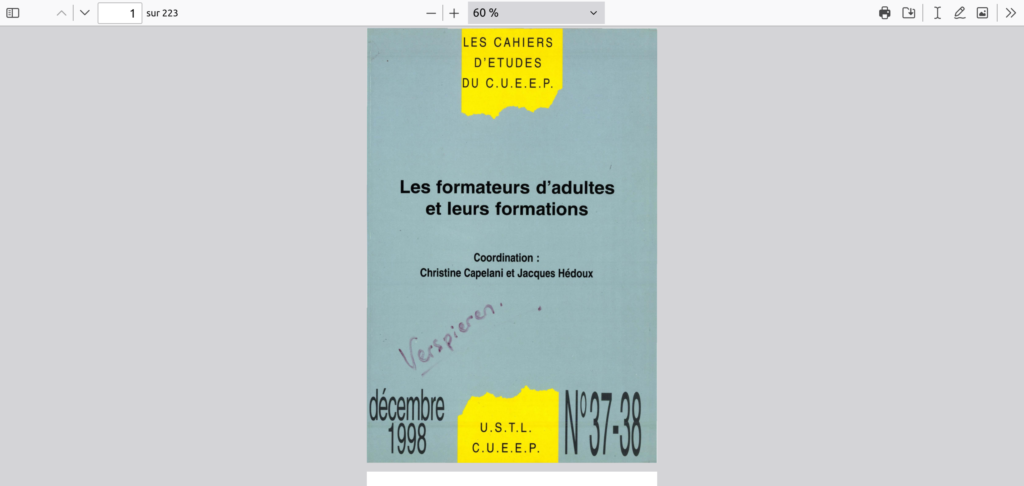
Christine Capelani et Jacques Hédoux, tous deux maîtres de conférence, animent ce sous-groupe de recherche intitulé »Agents éducatifs, identités, itinéraires, situations, pratiques et formations professionnelles » .
Les auteurs de cet ouvrage sont professionnels de la Formation d’adultes ou du Travail social, étudiants en maîtrise de Sciences de l’Education, en DEA, doctorants ou enseignants-chercheurs.
Et voici, en intégralité, l’article que j’y ai commis :
ITINÉRAIRE DE VIE ET DE FORMATION : IDENTITÉ PROFESSIONNELLE ET CHOIX AXIOLOGIQUES
Par Marie VLAMYNCK
INTRODUCTION
Au travers de ce texte, je tente de fournir des éléments de compréhension d’un
parcours individuel et surtout d’éclairer en quoi la formation a pu être, d’une part, déclencheur ou tout au moins facteur central de réinsertion professionnelle et de promotion sociale, et, d’autre part , facteur influant sur les choix et la position professionnels. Souvenirs, photos, « introspection » ont fourni matière à
l’évocation de ces étapes de vie. Évocation incomplète, superficielle et
inexacte. Bien sûr.
Mon souhait implicite est modeste : faire apparaître quelques moments où une
histoire individuelle bascule, en fonction de l’environnement familial et
historique, mais également en fonction des choix propres du sujet. A travers les
éléments biographiques que je fournis ici, le lecteur pourra constater que les
choix du sujet ont été marqués fortement dans un premier temps par des
valeurs familiales contradictoires, les adoptant puis les rejetant tour à tour ;
dans un second temps par les apports d’un parcours de formation continue.
J’énonce ici trois idées centrales que je souhaitais transmettre aux lecteurs :
• J’ai, en tant que sujet, élaboré des choix parmi les valeurs reçues dans
mon enfance. L’école, « l’instruction » et la formation y ont une place centrale.
• Mon parcours en Formation Professionnelle Continue a conforté et élargi ces choix de valeurs tout en me fournissant des outils d’analyse et de contextualisation.
• Ces valeurs initiales, revisitées par les apports d’un parcours de formation continue, ont influencé mes choix professionnels et, à l’intérieur de ces choix, mes positions professionnelles.
Une première partie fournit les éléments du contexte familial propres à planter
le décor dans lequel j’ai évolué et construit mon parcours de vie. J’y expose les
valeurs familiales qui ont nourri mon enfance et mon adolescence, notamment
les valeurs qui concernent l’école et le travail.
Une deuxième partie présente une courte biographie, en insistant sur les
éléments qui relèvent des contextes professionnels et de formation.
Une troisième partie relate mon parcours en formation continue, axe central
d’une démarche de réinsertion et de promotion sociale après une phase de
rupture familiale et professionnelle, mais aussi source d’apports conceptuels
permettant d’effectuer un retour réflexif et des choix axiologiques.
Enfin, une quatrième partie rend compte des incidences, quant à mes choix et ma position professionnels récents, issus de ces choix axiologiques.
1. ÉLÉMENTS DE CONTEXTE FAMILIAL
Quatrième et dernière enfant d’une famille ouvrière, j’ai été nourrie de
conceptions contradictoires de l’école, de la formation et du travail. J’ai grandi
dans une première idée que l’école était un lieu d’attente. Attente d’avoir enfin
l’âge pour « aller travailler ». « C’est au pied du mur qu’on voit le maçon »; « tant
que t’auras des bras, t’auras pas faim » sont, parmi d’autres, les proverbes qui
ont nourri mes représentations de l’école et du travail. Quant au travail,
j’entendais souvent dire que « les cols blancs sont des fainéants; ils vont
longtemps à l’école parce qu’ils ne savent rien faire de leurs 10 doigts ».
Lors des conversations familiales, s’il y avait une décision à prendre, seuls
avaient droit à la parole ceux qui ramenaient de l’argent, qui gagnaient leur vie.
Toute tentative d’avancer un point de vue était stoppée par la phrase sans
appel de mon père: »pour pourvoir la ramener ici, y faut ramener des sous ».
Quant à la scolarité des filles, ça ne sert pas à grand chose ; elles vont se
marier et avoir des enfants.
Cette analyse était en fait celle exprimée par mon père. Fils d’un ouvrier et
d’une ouvrière du textile, orphelin de père à 14 ans, il s’est dépêché d’obtenir le
Certificat d’Études pour pouvoir quitter l’école avant l’âge légal (12 ans à
l’époque, en 1932). Plus tard, employé à la filature, il préparera un diplôme
d’électrotechnicien en cours du soir. 1936 et le Front Populaire passeront par
là : il découvre l’accordéon et la fête dans la rue ; il découvre la politique et
l’envie de s’en sortir. Il adhère aux idées communistes, et s’affiche très
ouvertement libre penseur, fustigeant l’église catholique et ses représentants à
chaque occasion. En septembre 1939, il se marie, mon frère aîné va naître en
décembre 39.
Durant la guerre 39-45, à 18 ans mon père sera tout à tour mineur, prisonnier,
évadé, accordéoniste dans une maison close, prisonnier, évadé à nouveau,
ouvrier de filature, prisonnier et évadé pour la troisième fois. En 1942, il a 21
ans. Né en France de parents belges, il a, à l’époque, le choix de sa nationalité.
Il choisit de devenir français.
Après la guerre, il sera embauché dans une grande entreprise de soudage. Il
adhère à la CGT dont il sera un militant actif durant toute sa vie professionnelle.
Formé par l’entreprise, il y évoluera jusqu’à un poste de cadre technique.
Meilleur ouvrier de France en soudage, il participera à la réalisation du premier
prototype de Concorde. Cet épisode alimentera la fierté familiale.
Ainsi, bien que tenant un discours dévalorisant l’école et la formation, il a lui-
même largement mobilisé les possibilités de formations initiale et continue de
son époque, comme éléments de promotion sociale. De même se félicitera-t-il
de mes réussites scolaires, tout en ironisant sur le peu de profits financiers que
j’en tirerai. Ainsi pour lui, si l’école et la formation se justifient, c’est en tant
qu’elles amènent une meilleure position sociale, un meilleur salaire. Il a
constitué pour moi un modèle, une référence : il est possible de se former et de
progresser socialement.
Mais j’ai grandi également dans l’idée que l’école était un lieu de valorisation,
un lieu où porter haut la réputation de la famille. A ma sœur ramenant un
bulletin médiocre, ma mère dira : « tu veux que tous les autres croient qu’on
est des imbéciles? » Ce que je ne pourrais rendre, c’est l’accent et le ton, mes
parents ayant toujours parlé le patois du Nord.
Une troisième conception de l’école nourrissait également la famille : l’école
comme outil d’indépendance et de liberté. Quant à l’éducation des filles, ma
mère développera toujours un discours radicalement opposé à celui de mon
père. Pour lui, une fille se pliera aux décisions de son mari, à l’éducation de ses
enfants.
Pour ma mère, une fille doit absolument avoir un métier. Son argument
est qu’il ne faut jamais dépendre d’un homme, qu’il faut pouvoir se débrouiller
seule. Son expérience personnelle a dû peser lourd dans l’énergie et la
conviction qu’elle déploiera à ce propos.
Née en 1917, elle ne connaîtra pas son père, mort au Chemin des Dames. Sa
mère, ouvrière en filature, élèvera seule trois enfants, tout en ayant à charge sa
propre mère infirme. Celle-ci, née en 1860 sera couturière « à son compte »,
réalisant des vêtements pour les « belles dames de la haute » selon l’expression
de ma mère. Les évolutions de l’industrie textile amèneront la disparition de ces
couturières indépendantes.
Dernière enfant, ma mère se verra très tôt confier la charge de la maison
pendant que sa mère et ses frères et sœurs travaillent. Elle apprendra ainsi à
lire sur le journal et à compter avec sa grand-mère. Ma mère ne saura jamais
écrire que son nom et celui de ses enfants. Elle ne connaîtra l’école que durant
six mois. Mais si elle n’écrivait pas, ma mère lisait beaucoup, surtout des
romans et de la poésie. Elle était capable de réciter un nombre impressionnant
de poèmes, de raconter des romans : Victor Hugo, Émile Zola, Albert Samain,
sont parmi ses préférés. A 12 ans, en 1929, elle rejoint la filature. A cet âge
également, et en totale contradiction avec les valeurs de sa famille, elle
découvre la religion catholique et se fait baptiser. Plus tard, elle obtiendra de
mon père « bouffeur de curés » de scolariser tous ses enfants dans
l’enseignement privé catholique.
Ma mère ne connaîtra aucune autre forme de formation initiale ou continue.
Mariée et mère d’un enfant au début de la seconde guerre mondiale, elle
travaillera de manière intermittente, toujours en filature, pour subvenir à ses
besoins, à ceux de son fils mais aussi à ceux de son mari, souvent évadé et
qu’il fallait cacher entre deux dénonciations. Résistants, mes parents cacheront
des armes tout au long de la guerre et participeront activement à des actes de
sabotage.
De 1947 à 1955, mes parents auront trois autres enfants. Ma mère reste à la
maison et ne retravaillera plus. De plus, un cancer vient affecter gravement sa
santé. Elle guérira grâce à un douloureux traitement au radium, traitement dont
les séquelles la feront souffrir jusqu’à la fin de sa vie.
Ce détour m’a paru important pour situer les dynamiques et les contradictions
dans lesquelles j’ai abordé l’école et la formation. Pour résumer, je caractériserai ainsi les messages explicites reçus :
• L’école ne sert à rien
• Les études ne sont pas pour « des gens comme nous »
• Réussir à l’école, c’est prouver son intelligence
• Réussir à l’école, c’est se donner les moyens de l’indépendance.
Mais il y eut également des messages implicites et parmi ceux-ci, je relève la
possibilité de se former et de progresser socialement dont mon père a fourni
l’exemple, contredisant ainsi lui-même ses propres discours.
Certaines des valeurs portées par mes parents ont eu, comme nous le verrons,
une grande importance dans mes choix de vie et de formation. D’autres, au
contraire, ont été rejetées ou ignorées.
2. ELEMENTS DE BIOGRAPHIE
Je propose à présent de fournir les éléments de mon parcours personnel,
professionnel et de formation. Je tenterai au fur et à mesure de dégager les
éléments significatifs quant à l’impact des valeurs familiales sur mes choix ou
mes non-choix.
Je suis née en 1955 dans une petite maison de deux pièces superposées, dans
une courée d’une dizaine de maisons, à La Madeleine dans le Nord. L’eau était
tirée à la pompe, dans la cour. Les latrines, un trou dans une planche au-
dessus d’une fosse, étaient communes à toutes les maisons de la courée.
Nous vivions à six, mes parents et leurs quatre enfants. Deux bergers allemands nous tenaient compagnie.
Lorsque j’ai eu cinq ans, mes parents ont pu, grâce à l’employeur de mon père,
accéder à la propriété. Son patron s’est en effet porté caution des prêts
bancaires nécessaires pour acquérir une maison dans ce qu’on appelle une
« cité-jardin » dans la banlieue de Lille. Ce fut un changement de cadre de vie
important : quatre chambres, une salle de bain, de l’eau chaude, un jardin …
Scolarisée à partir de 6 ans et jusqu’en 6eme dans une école catholique, je suis
ce qu’il est convenu d’appeler une bonne élève, sage et discrète. Le souvenir
de cette période le plus marquant à mes yeux est la découverte du français en
tant que langue. A la maison, nous parlions le patois, les amis de mes parents
aussi, et la plupart des voisins également. Je n’entendais le français que dans
les magasins, où j’allais peu.
A 6 ans également, je découvre l’église, puisqu’avec d’autres enfants de l’école, nous sommes fortement priés d’assister à la messe du dimanche. A l’église, c’est encore une autre langue que j’entends, le latin. Quand j’ai 8 ans, en janvier 1963, mon frère aîné se marie et quitte la maison. J’ai peu de souvenirs de lui à cette époque : il vient de passer 28 mois en Algérie. J’entendrais souvent par la suite ma mère dire que la guerre lui a changé son petit, qu’il est « cassé ».
Mes frères, plus âgés que moi de 16 et 7 ans ont tous les deux quitté l’école à
12 ans sans obtenir de diplôme et travaillent à la chaîne dans une usine de
construction de machines agricoles de la région lilloise. Mon frère aîné fera
toute sa carrière professionnelle dans cette usine, jusqu’à sa fermeture,
« profitant » alors du plan de retraite anticipée. Mon second frère travaillera dans
cette même usine de 1961 à 1970, puis, se formant par lui-même, il occupera
des postes de plus en plus qualifiés dans le soudage et la construction
mécanique pour plusieurs employeurs.
Aucun de mes deux frères n’a suivi de formation professionnelle continue. Le modèle prôné par le père a ici bien fonctionné :
« l’école ne sert à rien, il faut travailler le plus vite possible ». Ce n’est pourtant
pas l’objectif d’avoir de l’argent qui les motive pour travailler lorsqu’ils ont 14
ans : en effet, il est de règle de donner intégralement son salaire aux parents.
Ceux-ci reversent de l’argent de poche pour les cigarettes et pour boire un
verre à la sortie de l’usine. Les autres besoins d’argent se négocient au coup
par coup. Une part importante du salaire est « mise de côté » par ma mère pour
payer le futur mariage et acheter les premiers meubles.
Ma sœur quittera l’école à 14 ans. Plus tard, elle intègre une formation
rémunérée d’infirmière en psychiatrie dont le diplôme n’est toutefois pas
équivalent à un diplôme d’État d’infirmière.
Quant à moi, au cours de la 6eme, j’entends parler par d’autres élèves de
« lycée », d’école possible après 16 ans. Les grands frères et sœurs de mes
amies d’école sont au lycée. Le milieu social d’origine des autres élèves n’est
pas identique au mien. L’école privée, dans le souvenir que j’en ai, n’accueille
pas beaucoup d’enfants de prolétaires …
Quand je demande à mes parents de quitter l’école privée pour aller au lycée
de la ville voisine, mon père refuse. J’ai dû entendre pour la première fois à
cette occasion: « elle veut péter plus haut que son cul ». Je suis confrontée et je
m’oppose à la conception que les études ne sont pas pour « des gens comme
nous ». Ma mère me soutient dans mon projet et cherchant une alliée, va en
discuter avec la directrice de l’école. Celle-ci la rappelle aux dures réalités de
l’existence : les études coûtent cher et il n’est pas souhaitable de vouloir sortir
de son milieu. De soncôté, mon père ne se laisse pas fléchir.
En 1968, je suis en 5ème. Mes souvenirs de cette période sont confus comme
peuvent l’être les souvenirs d’enfance. Mon père et mon second frère sont toute
la journée à la maison et se disputent beaucoup. Je ne comprends pas
pourquoi. Il n’y a plus d’école. Dans les rues, les poubelles s’amoncellent. Il fait
beau. Je suis peu à la maison, je « traîne » avec des copines de l’école mais
surtout avec la grande sœur de l’une d’entre elles. Elle a 17 ans et elle est en
première au lycée. Au cours d’une ballade à Lille, je m’arrête devant un grand
bâtiment. De nombreux jeunes discutent sur les marches. J’entre. Sans le
savoir, je viens d’entrer dans la Faculté des Lettres de la rue Angellier. Dans
une salle, un jeune barbu gesticule et parle de révolution.
Mon père refuse une nouvelle fois de me laisser aller au lycée. Il trouve déjà
que la nouvelle loi qui oblige l’école jusqu’à 16 ans est « une connerie ». Durant
plusieurs jours, en compagnie de mon amie de 17 ans, nous allons fuguer.
Lorsque les gendarmes m’arrêtent et me demandent pourquoi je me suis
sauvée, je leur réponds que je veux aller au lycée. Je pense que j’ai dû les
étonner !
Au retour à la maison, ma mère négocie mon passage au lycée. Puisque je ne
gagnerai pas d’argent avant de me marier, je n’aurai rien à mon mariage, ni
fête, ni meubles, ni argent. Mon père insiste sur le ridicule de se marier sans
robe blanche, sans invités, sans repas. Il pense que je vais choisir le mariage.
Je choisis le lycée.
Je passerai un bac littéraire en 74, après des années de scolarité houleuse: la
petite fille sage ne l’est plus. Je vis ce qu’il est convenu d’appeler une
adolescence difficile.
L’annéeduBac est aussil’annéeoùje me marie.Danslaplusstricte intimité,puisquemonpère,fidèleà saparole,neveutrienmepayer,cequi me convienttout à fait.Mabelle-mère,néeen1926, esttitulairedubaccalauréatet exercelemétierd’institutrice dans une grande institutioncatholiquedeLille.Divorcée,elleélèveseulsonfilsdontelleespèrequ’ilfera des études supérieures et deviendraingénieur.Ilquitteralelycéeen1èreetsemontreraunparfait autodidacte pourseformer àcequil’intéresse.Passionnédemodélisme,etplusgénéralementdetoutcequiconcernelevent,ilconstruirasesdifférentesoccupationsprofessionnellesenfonctiondecettepassion:mécanicien,vendeurdemodèlesréduits, artisanvoilier…Maisen75,après une première année deDEUGdephilosophie,ilmefautgagnermavie.Monmari part fairesonservicemilitaire.Je passealorsleconcours d’entréedel’EducationSurveillée,cequipermet de me prépareraumétier d’éducateur toutenétant rémunérée. Jemesens attirée par ce métier.Ilmesembleque je suisbienplacéepour comprendreetaider des jeunesenrupturefamilialeetsociale.A son retourduservicemilitaire,monmari trouveramonmétier trop prenant.Sansune hésitation, je démissionne. A cette époque,mavie decouplepasseavant tout. Nous vivons des petitsboulotsdemonmari.Ila arrêté ses étudesenpremière puis suiviuneformationdedessinateur technique àI’AFPAmaisilnesesatisfait pasdetravaillercommesalarié.Noussommes danslesannées70et nous vivonsdemanièreplutôtmarginaleetpeusédentaire. Durant cettepériode, je suisenrupturetotaleaveclesvaleursdemafamille,notammentlavaleur« travail ».En78, naîtmonfils.Jel’élèveraisanstravaillerpendant deux ans.Savenueprovoqueunchangement dans notrevie.Nous souhaitons uneplusgrandestabilitéfinancière.Nousallonstravaillerdurantsixansdansunegrandesurface,entant que vendeurs, mon mari trouvantlàunpremiertravailenlienavecsapassiondesmodèlesréduits.En84,suivantsesidées et ses projets, mon marinesupportepluslestatutdesalariéet décide de créer sa propre entreprise. Quant à moi, inactive depuisplusieursmoispour raisonsde santé,jenereprendspasmonemploiaumagasinetjevaiscollaborer,à titregracieux,àl’entreprisedemonmari,assurantlacomptabilitéetlagestion courante.C’est ainsi qu’en1990,lorsde notre séparation, jenepeux prétendre à aucuneindemnité.L’allocationde parentisolé,puisleAMI,vont me permettredefaireface à cette période.
3. UNE FORMATION POUR UNE REINSERTION PROFESSIONNELLE et DES APPORTS CONCEPTUELS
Une annonce dans le journal « La Voix du Nord » en juin 91 sera le déclencheur
de ma réinsertion professionnelle. Un organisme de formation proposait à des
femmes un temps de bilan personnel et professionnel. J’y suis allée, motivée
par la curiosité, pour faire quelque chose, pour voir des gens. J’y ai trouvé des
personnes chaleureuses. Je n’avais aucune idée de ce que je voulais faire au
niveau professionnel ; je me sentais « au point mort ».
Dans l’entreprise de mon mari, j’avais souvent accueilli des jeunes stagiaires ou
des adultes en reconversion. D’autre part, j’étais engagé dans un certain
nombre d’activités associatives: secrétaire d’une section sportive, secrétaire
d’une association de maintien à domicile de personnes âgées. A travers mes
diverses activités, la dimension éducative était pour moi toujours présente.
J’éprouvais le besoin de retravailler avec des jeunes mais je ne souhaitais pas
redevenir éducatrice.
En manière de boutade, j’ai demandé à l’animatrice de ce stage comment il
fallait s’y prendre pour faire son métier ? Elle m’a alors parlé du DUFA (Diplôme
Universitaire de Formateurs d’Adultes). Quelques jours plus tard, je retirais un
dossier de candidature et j’entamais la formation en octobre 91. Une
Conseillère en Formation Continue m’a permis de remplacer le RMI par une
rémunération de stagiaire de la formation professionnelle.
Dans le cadre de la formation au DUFA, il est demandé aux étudiants de
réaliser un stage d’observation dans un organisme. Je passais donc une
semaine dans un organisme de formation s’adressant en priorité aux jeunes en
grande difficulté. Quelques mois plus tard, j’envoyais à cet organisme une
candidature spontanée. J’avais repris suffisamment de force pour me remettre
en activité. La réponse de l’organisme fut positive.
Depuis septembre 92, je travaille dans cet organisme en tant que formatrice sur
des actions de lutte contre l’illettrisme à destination de jeunes 16-25 ans. Tout
comme pour les jeunes de l’Education Surveillée que j’ai eu à connaître, je me
sens particulièrement concernée par les jeunes en situation d’illettrisme. Ma
mère ne savait pas écrire et je l’ai vue chaque jour confrontée à cette difficulté
bien que l’on ne puisse comparer l’illettrisme actuel des jeunes (notion récente
apparue dans les années 70 pour désigner la non-maîtrise des savoirs de base
chez des personnes ayant eu une scolarité de plusieurs années) et
l’analphabétisme relatif des anciennes générations, socialement accepté, non
stigmatisé comme facteur d’exclusion à une époque où lire/écrire n’avait pas
d’incidence sur l’accès au monde du travail.
Depuis 92, je n’ai pas interrompu mon parcours de formation. Après l’obtention
du DUFA en 94, j’ai préparé une licence puis une maîtrise en Sciences de
l’Education obtenue en 96. En 97, j’ai poursuivi avec la préparation d’un DEA
en Sciences de l’Education.
En 98, j’entame la préparation d’une thèse de Doctorat en Sciences de
l’Education.
L’obtention de ces diplômes a eu des conséquences sur ma vie professionnelle.
Au sein de l’organisme où je travaille, mes diplômes ont été reconnus et
valorisés par un élargissement de mes responsabilités et de conséquentes
augmentations de salaire.
De plus, j’ai la perspective aujourd’hui d’intervenir en formation de formateurs,
dans le cadre du DUFA, bouclant ainsi la boucle de l’accès à une situation
sociale différente et, à mes yeux tout au moins, supérieure à celles que j’ai pu
connaître par le passé. La formation professionnelle continue m’a permis de
retrouver un emploi, de m’y stabiliser (CDI) et d’y évoluer, tant au niveau de la
variété des tâches et des responsabilités qu’au niveau financier, remplissant
ainsi un rôle déterminant d’insertion et de promotion sociale. En ceci, j’ai
reproduit une part du modèle paternel : se former et progresser socialement. Je
me suis également donné les moyens de l’indépendance chère à ma mère.
A travers les éléments biographiques relatés, je peux repérer des choix
axiologiques. En ce qui concerne les valeurs concernant l’école, la formation
et le travail, j’ai opéré un mélange entre les valeurs paternelles et maternelles.
De mon père comme de ma mère, j’ai repris à mon compte l’importance de la
valeur travail et du travail bien fait.
De mon père, ce n’est pas le discours qui m’a influencée mais bien plutôt le
modèle de référence que sa propre vie m’a fourni : promotion sociale grâce à la
formation professionnelle, attachement à des valeurs syndicales et politiques
pour le mieux vivre des ouvriers. De sorte que mon rapport à l’école, aux
savoirs n’a pas été (ou peu) marqué par le discours paternel sur l’inutilité de
l’école et de la formation mais plutôt par l’exemple de son propre parcours.
C’est donc à ma mère que je dois cet attachement à l’école et à la formation
comme outils de promotion et de libération. Grâce à l’école, j’ai pu aborder un
milieu différent de mon milieu d’origine, accéder à des choix professionnels et
sociaux différents.
Aborder un milieu différent par le mariage tout d’abord : mes parents et ma
belle-mère ne sont pas du même milieu social. Tandis que ma mère ne sait pas
écrire, ma belle-mère (divorcée d’un propriétaire-gérant d’auto-école) est
bachelière et elle concevra et exprimera des inquiétudes quant à ma volonté de
vouloir « changer de milieu ». Elle sera rassurée par mon attachement aux études
qui donnait un air sérieux à un personnage de jeune fille en moto assez
éloignée de ses représentations de la bru idéale ….
Accéder à des choix professionnels différents ensuite: j’ai rejeté le modèle
paternel de la femme au foyer chargée uniquement d’élever les enfants et,
mises à part les années de marginalité, j’ai toujours travaillé.
Lors de la séparation d’avec mon mari, je comprends mieux la mise en garde
de ma mère de ne pas dépendre d’un homme. Travaillant avec lui et pour lui, il
ne me reste rien.
Je prendrai également de ma mère le goût du travail et de l’action pour les
autres et avec les autres. Rendre service, aider, porter secours sont les thèmes
de la plupart des histoires qu’elle me raconte. Chiens abandonnés et moineaux
blessés trouvent toujours une place dans sa cuisine ! Toutefois, si elle est
sensible aux inégalités et à l’injustice, ma mère en a une approche plutôt
catholique : faire le bien, aider son prochain, faire la charité.
De l’action syndicale de mon père et de son discours à ce sujet, je ne voyais
que les grèves, les luttes pour des augmentations de salaire : « les patrons sont
des voleurs, ils peuvent payer », il suffit d’être assez nombreux et déterminés
pour faire pression.
Les intérêts à court terme sont dominants dans son approche des situations. Il
souhaite progresser, voir sa situation s’améliorer mais n’envisage pas de
changement plus radical de la société.
De mes deux parents enfin je prendrai aussi un attachement à l’action
commune, l’idée que l’union fait la force. A travers les récits de la guerre et de
la résistance, mais aussi ceux des grèves et des actions syndicales, je conçois
le monde comme une opposition de forces dans laquelle il faut choisir son
camp.
Mon parcours en formation continue en Sciences de l’éducation m’a permis de
contextualiser ces valeurs familiales et de les situer dans un cadre d’analyse
qui leur donne sens et qui m’a ouvert des perspectives quant à mes choix et ma position professionnelle.
Le concept de qualification sociale va me permettre particulièrement d’analyser ces choix. Paul Demunter l’énonce comme la « capacité pour les travailleurs de se situer clairement dans les rapports de production, prise de conscience que la place qu’ils occupent détermine leur situation dans le système, capacité de s’organiser, capacité de concevoir des projets d’intervention sur leur environnement, capacité de développer des actions collectives en vue de modifier leur situation et de résoudre leurs problèmes.
La qualification sociale est un besoin de formation lié aux intérêts de la classe
ouvrière. Deux sortes de besoins sont distingués : les besoins immédiats (tels
que faire valoir ses droits, obtenir des augmentations de salaire, lutter pour
l’amélioration de ses conditions de travail, la promotion sociale) et les besoins
stratégiques qui visent à transformer radicalement la société et les rapports
sociaux.
Rapportés aux éléments biographiques exposés, ces concepts permettent
d’éclairer la position de classe de ma famille et le type de besoin visé par
l’action. Membre de la classe ouvrière, mon père lutte et agit, syndicalement et
politiquement pour l’amélioration de la condition ouvrière dans la satisfaction de ses besoins immédiats : promotion sociale, augmentation de salaire … Pour ma part, la formation continue a eu, nous l’avons vu, une incidence de ce type,
favorisant ma réinsertion et ma promotion sociale.
Mais au delà de cet aspect, nous verrons que je tente d’inscrire mes choix
professionnels et ma position professionnelle dans une volonté d’agir pour la
satisfaction des besoins stratégiques de ma classe sociale.
Ainsi j’ai repéré à travers ce bref récit de mon parcours de vie et de formation
des valeurs centrales dans ma construction/reconstruction identitaire : d’une
part l’importance de la formation dans un souci d’insertion et de promotion
sociale ; d’autre part les apports conceptuels qui me permettent de me situer
dans les rapports sociaux et d’y inscrire une action finalisée par mes choix
axiologiques.
Qu’en est-il de ces choix axiologiques au regard de mes choix
professionnels de formatrice d’adultes ? Portée par ces valeurs, quel type
de professionnelle suis-je devenue ?
4. CHOIX ET POSITION PROFESSIONNELS
Tout d’abord, le choix de la profession de formatrice d’adulte doit un peu au
hasard d’une rencontre avec une formatrice. Mais cette rencontre n’aurait rien
donné si elle n’avait mobilisé en moi un intérêt déjà construit pour un type de
public et une certaine volonté d’action sociale. En effet, le métier de formateur
d’adultes recouvre des réalités professionnelles variées : il peut s’exercer
auprès de publics très différents, porter sur des contenus eux-mêmes très
divers, et proposer des statuts et des rémunérations inégaux. De par mes
expériences antérieures, les contenus de gestion, de comptabilité, me
semblaient les plus proches.
Lors de ma première immersion dans un centre de formation (Stage
d’observation DUFA), je rencontre un public de jeunes en grande difficulté
d’insertion sociale et professionnelle. Parmi leurs difficultés, il y a l’illettrisme.
Cette difficulté ne m’est pas inconnue. Aussi, lorsque cet organisme de
formation m’embauchera, c’est sur une action de lutte contre l’illettrisme que je
demanderai à travailler. Depuis 92, je manifeste le désir de continuer à travailler
sur ce type d’action. De sorte que si le métier de formatrice est le fruit d’un
certain hasard, le choix du public est, quant à lui, volontaire. Je me sentais à
même de comprendre et d’agir à ce niveau.
Cependant, une contradiction s’est rapidement manifestée entre la pratique au
quotidien d’une part, et mes choix axiologiques et les apports de ma formation
en Sciences de l’éducation d’autre part. Contradiction m’obligeant à
m’interroger sur le sens de mon action pédagogique: qu’est-ce que je veux
faire, avec, pour et contre mes stagiaires?
On peut distinguer dans les différentes conceptions de la lutte contre l’illettrisme
deux grandes tendances : d’une part une approche technique, purement
fonctionnelle des difficultés langagières, d’autre part une approche
communicationnelle, plus globale, resituant le langage dans ses dimensions
sociales. Le langage oral et écrit n’est donc plus ici réduit à la maîtrise de règles
phonologiques, syntaxiques, sémantiques etc .. le langage est social, il traduit la
position sociale de celui qui parle.
De sorte que l’activité du formateur peut être axée, finalisée, par le choix de
l’une ou l’autre de ces tendances. De manière un peu caricaturale, on pourrait
dire que dans la première tendance, il s’agit de transmettre le bien parler, le
bien lire, le bien écrire en fonction de normes scolaires et sociales incontestées.
L’illettré est un inadapté à qui l’on doit faire acquérir les moyens langagiers
d’une possible insertion. L’approche sera donc très fonctionnelle et adaptative :
remplir des papiers, maîtriser l’oral pour réussir un entretien d’embauche,
acquérir une bonne orthographe. Nous retrouvons ici une volonté de
satisfaction des besoins immédiats des publics en fonction des normes et des
valeurs sociales dominantes.
Dans la seconde tendance, le formateur tentera de mettre en œuvre le concept
de qualification sociale précédemment défini et de créer les conditions d’une
« prise de parole » des publics : prise de parole au sens où le stagiaire se
l’approprie, la fait sienne et l’utilise pour prendre conscience de sa place dans le
système et construire des actions transformatrices et non plus seulement
adaptatrices, devenant ainsi un acteur social. Mais prise de parole également
pour le formateur qui se rend lui-même acteur social, acteur éducatif.
Il ne s’agit donc pas ici de prescrire ce que le formateur est censé connaître
comme étant bon et juste pour les apprenants mais plutôt de construire avec
eux. Et parfois contre eux puisqu’il s’agit aussi de résister à leurs demandes de
satisfaction de besoins immédiats.
Cette seconde position professionnelle, que je tente de mettre en œuvre, met
ainsi en cohérence mes choix axiologiques et praxéologiques.
Enfin, l’intérêt pour l’action collective m’a amené à assumer les fonctions de
déléguée du personnel.
CONCLUSION
Je souhaite tout d’abord que ce récit présente un intérêt quelconque pour le
lecteur.
Pour ma part, ce retour en arrière, ce travail réflexif sur quelques éléments de
ma vie provoque en moi une réaction d’étonnement. J’y prends conscience de
manière plus forte que je n’avais pu le faire auparavant des nombreux éléments
qui ont déterminé mes choix ou ce que j’ai pu appeler des choix.
M’apparaissent également de manière plus évidente les inévitables
contradictions entre les différents messages reçus de mes parents.
Mais l’apport fondamental de ce retour réflexif me semble résider dans la mise
en évidence de valeurs :
• Valeurs acquises dans la famille quant au travail et à la formation, mais
aussi une certaine conscience de mon appartenance et de ma position
de classe.
• Valeurs acquises par la formation permettant d’intégrer et de rendre
signifiantes ces valeurs initiales, de les intégrer dans un cadre
conceptuel éclairant et guidant l’action.
BIBLIOGRAPHIE
BERTAUX, Daniel, (1997), Les récits de vie, Paris, Nathan, 128 p.
BOURDIEU, Pierre, (1991 ), Ce que parler veut dire, Fayard, 238 p.
DEMUNTER, Paul, (1983), La qualification sociale: un concept à opérationnaliser, Document de travail, Conseil scientifique FUNOC.
FREIRE, Paulo, (1969), Pédagogie des opprimés, Maspero, 197 p.
GIROD, Roger, (1997), L’illettrisme, PUF, « Que sais-je? », 127 p.
VERNIERS, Marie-Christiane, (1985), La qualification sociale: un nouveau besoin de formation, Cahier du CUEEP n°3.
VLAMYNCK, Marie, (1997), Le corps de la lettre, Mémoire de DEA en Sciences de l’éducation, Lille 1, 128 p